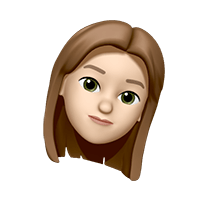
Sophie Delong
Responsable de compte
TABLE DES MATIÈRES
Introduction
Préparer un mémoire commence par chercher et définir le sujet. Celui-ci est l’élément base de la rédaction académique. Il détermine sur quelle discipline se focalise l’étudiant et quel aspect de celle-ci sera traité. En architecture, trouver un sujet pertinent peut devenir un défi. Entre les idées percutantes, la contextualisation et la disponibilité des ressources, les étudiants sont perdus. Voici quelques pistes d’idées sur lesquelles vous pouvez vous pencher.
Exemples de sujets de mémoire en architecture
Renforcement structurel des constructions et troubles climatiques sur les côtes : violence des ouragans et des cyclones.
Récemment, les catastrophes naturelles sont de plus en plus violentes. Les maisons croulent sous la force combinée des vents et de la pluie. Il ne s’agit pas de simples catastrophes car elles sont modifiées par le changement climatique. Il peut être question d’études comparatives ou une analyse de cas (ex : projet de reconsidération des structures proches des côtes). On peut ainsi conduire les recherches vers des projets de nouvelles conceptions.
Densité urbaine et architecture bioclimatique dans les grandes agglomérations.
Les projets énergétiques représentent un défi de taille dans les villes à forte densité. On peut commencer par des simulations thermiques en utilisant des logiciels comme EnergyPlus. C’est un projet d’amorce pouvant être couplé à une étude de cas comme certaines villes de la Chine. L’étudiant devra tenir compte du climat local, de la spécificité de chaque structure et des pratiques des habitants. L’idéal est de basculer vers des solutions écologiques effectives sur le long terme.
Rénovation des patrimoines culturels sans altérer la valeur historique.
Le vrai problème des patrimoines très anciens est leur valeur. Leur histoire est reflétée par l’aspect de l’architecture, les matériaux qui la composent et les techniques de construction. On doit ainsi considérer son histoire et effectuer une analyse architecturale. L’étudiant devra tenir compte de l’authenticité de l’ouvrage tout en intégrant les rénovations modernes.
Reconstruction post-guerre : entre réconciliation sociale et réappropriation de l’identité culturelle.
La guerre a toujours été une situation problématique. Après cette pénible période, les villes ou villages se retrouvent complètement détruites. On peut mettre en place des projets de construction participative (réconciliation sociale) et reconstruire l’identité collective culturelle. Ce sujet est assez complexe car il faudra ainsi considérer la multiculturalité locale (s’il y en a).
Petite île à forte densité de population et montée des eaux probables face aux changements climatiques : la problématique de l’architecture locale.
En guise de cas à étudier, vous pouvez prendre l’île de Santa Cruz del Islote, dans l’archipel de San Bernardo en Colombie. L’île est surpeuplée alors qu’elle n’est pas plus grande qu’un terrain de foot. Plus de 1000 personnes s’y entassent. Même si l’environnement semble calme, cette île et ses infrastructures ne sont pas à l’abri lors d’une catastrophe climatique. Il est question de trouver des alternatives face à la montée des eaux par exemple (piste possible : architecture amphibie).
Incapacité de reproduire la robustesse des architectures millénaires.
Les failles des techniques modernes. Les temples, châteaux, habitats millénaires sont réputés pour leur capacité à résister au temps. Pourtant nos ancêtres ne disposaient pas encore d’outils modernes technologiques (d’après les suppositions selon les études archéologiques). Comment alors expliquer la robustesse de ces anciennes structures et celles modernes qui, dès un simple passage d’ouragan, faillent rapidement ?
Le confort des étudiants via les logements modulaires.
L’optimisation des espaces est un problème de taille dans les structures académiques, que ce soit pour les espaces communs ou personnels. Les recherches s’axent sur des solutions modulaires comme les conteneurs recyclés pour construire des petits studios. Il ne s’agit d’une pratique mais d’un essai par étude sur une simulation 3D, fabriquer des prototypes et étudier la faisabilité.
Maisons intelligentes et défaillances techniques.
Les pays développés sont rapidement passés par des maisons connectées. Tout se commande à distance ou vocalement. La structure a ainsi été pensée pour que la maison soit entièrement indépendante. Mais les questions fusent autour des défaillances techniques et les promesses pour des structures plus sécurisées sur ce point.
Les structures des huttes africaines, un modèle d’analyse pour des structures adaptées face au contexte du réchauffement climatique.
Les zones africaines bénéficient d’un climat presque toute l’année. Les habitants ont construit des huttes qui sont des petites cabanes en mesure de donner un abri frais et ombragé. Elles absorbent la chaleur et peuvent lutter contre les intempéries. Il faut identifier chaque hutte et leur spécificité, à étudier comme modèle pour comprendre leur construction et leur capacité à ne pas absorber la chaleur.
Adaptation des techniques vernaculaires rurales aux techniques modernes pour le développement des zones rurales.
Dans le cadre du développement rural, les anciennes constructions devront passer par des rénovations voire des reconstructions. L’idéal est d’adapter les techniques vernaculaires à la modernisation. Le projet sera en accord avec les artisans locaux pour comprendre comment ils travaillent et coupler les idées modernes avec les constructions locales.
Fonctionnement des impressions 3D des maisons habitables.
Un des plus gros avantages de l’impression 3D c’est que vous pouvez avoir votre maison en moins de 24h (variable selon la capacité de la machine et la grandeur de la maison). Une étude profonde peut nous aider à connaître les inconvénients et les avantages de ce type de projet.
Fidélisation de la création et immersion en réalité virtuelle VR.
Hypothétiquement, il n’existe pas de ressemblance à 100% entre la simulation virtuelle et la réalité. Cela peut révéler une discorde avec les architectes car la question se pose sur la possibilité que la réalité virtuelle perturbe le processus créatif. On peut effectuer des analyses par des expérimentations avec des logiciels tels que Twinmotion.
Le bambou, le futur matériau des constructeurs.
Si le bambou a déjà été privilégié durant des années dans la plupart des pays asiatiques, il connaît une nouvelle image dans les constructions modernes. On étudie ainsi sa résistance, son esthétique et sa durabilité face aux contraintes climatiques actuelles. On peut prendre comme étude de cas l’œuvre à Bali, le Green School.
Les espaces de travail et l'intégration permanente des architectures biophilique.
Nous ne pouvons réfuter que la nature fait du bien à l’homme. De plus en plus de projets modernes intègrent les architectures biophiliques. Le but est de comprendre comment les intégrer et quel est leur rôle dans le bien-être social surtout dans les espaces communs.
Stratégies d’adaptation des infrastructures face au changement climatique.
La résilience est le meilleur moyen d’adaptation étant donné les dégâts provoqués par le changement climatique. On examine ainsi de nouvelles approches architecturales plus innovantes et en mesure de proposer des solutions pérennes. L’étudiant peut déjà commencer par des projets pilotes en spécifiant une zone géographique précise.
Rénovation de patrimoine et parfaire les structures grâce à la numérisation 3D.
La technologie de pointe a permis d’effectuer des simulations pour les rénovations. On se concentre ainsi sur l’aspect de la préservation architecturale et l’adaptation des nouvelles techniques pour répondre aux besoins des patrimoines bâtis. Prenez un exemple concret : un monument historique ayant déjà bénéficié de ce type d’intervention et ayant eu du succès.
Les cellules et la sécurité des architectures.
Rapport densité – nombre de locataires supportés par le bâtiment. Etude de cas : Hong-Kong. Certains les appellent cellules, d’autres cercueils et capsules (termes mélioratifs). Ce sont des micro-appartements d’à peine 5 m2. Les propriétaires face à l’explosion démographique peuvent transformer une chambre et la diviser en plusieurs cellules. Outre des conditions de vie infernale, on se pose des questions sur la sécurité qu’offrent ces micro-appartements.
La tendance du télétravail et multifonctionnalité des appartements.
Le Covid a propulsé la popularité du télétravail, à un tel point qu’aujourd’hui de plus en plus de personnes préfèrent travailler chez soi. Cela a radicalement changé notre rapport avec l’habitat et comment nous concevons la multifonctionnalité des appartements pour qu’ils s’adaptent aux nouveaux besoins.
Participation active de la communauté dans la conception des espaces communs.
Dans ce type d’étude, il s’agit d’explorer la co-créativité en ce qui concerne les espaces communs. Ce projet aborde une facette de l’architecture participative, comment les habitants maîtrisent les projets communautaires et en quoi ces projets leur seront bénéfiques autant sur le plan social que technique.
Innovation spatiale et approche intelligence par l’adoption des installations éphémères.
Les installations éphémères sont démontables, transportables et peuvent être installées en quelques heures, voire quelques minutes selon la complexité de la structure. On peut observer l’engagement du public et en quoi ces nouvelles structures sont bénéfiques dans la gestion des espaces surtout lors d’importants évènements (festival, fêtes, etc.) ou situation d’urgence (ouragan, cyclone, tremblements de terre, etc.).
Conclusion
Ces sujets offrent des potentiels d’exploration intéressants car ils abordent des situations actuelles. Ils répondent à des analyses théoriques applicables en pratique sur terrain. Toutefois, nous conseillons toujours d’étudier des cas accessibles pour mieux étudier la faisabilité des observations et des analyses.
